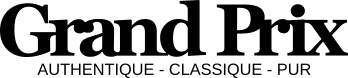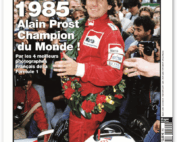DESTIN
COZETTE ET L’HÉLICO
Par Florence Dro

Je l’ai réellement découvert à… Vannes. Mon mari se faisait évacuer en hélicoptère par la protection civile. Pour le distraire, j’engageais la conversation avec le pilote : « Vous connaissez Michel Cozette ? » Il me répondit par l’affirmative, me confiant qu’il était un « cas d’école » : il avait une fois fait une chose qu’il n’aurait pas due. Et cela s’était mal fini…
Je le connais depuis longtemps. Pourtant, de cette histoire, je ne sais pas grand-chose. Il y a bien eu les pompiers de Paris, l’opéra, le basket, les hélicos, la montagne… Mais mettre tout cela bout à bout, je n’avais jamais osé le lui demander. Un soir d’été, j’ai pris mon courage à deux mains. Lui aussi, me semble-t-il. « Je suis né le 8 avril 1928 à Songeons, un petit village de l’Oise. Mais ne me demande pas pourquoi, je n’ai pas le moindre souvenir de ma petite enfance. Je ne crois pas qu’elle ait été très heureuse, c’est sans doute pour cela qu’il ne m’en reste rien. Ma mère était dure. A 16 ans, ma vie se partageait entre le collège de Beauvais et Songeons, le week-end, où je travaillais chez le marchand de vélos, à réparer des roues, des chambres à air… Cela me plaisait. Pendant la guerre, un peu moins… Lors de la retraite des Allemands, en 1944, alors qu’ils passaient par Songeons à vélo, à moto, en camion, etc., une auto a crevé. Ils se sont arrêtés et nous ont ordonné de réparer sur-le-champ la roue endommagée. Je m’y suis collé et je me suis ‘‘exécuté’’ avec le plus grand soin.

Le béret était le seul point commun entre un alpiniste et un Pyrénéen. Plus sérieusement, il fallait être bien cinglé pour monter là-haut par tous les temps, dans ces drôles d’engins.
Creuser sa propre tombe…
Mais à peine repartis, la roue a crevé à nouveau, un peu plus loin… Ils ont fait demi-tour, sont arrivés fous de rage en criant au sabotage. Ils voulaient exécuter le coupable. Je me suis retrouvé à creuser un trou de ma taille, sur la place de l’église, les fusils des Allemands prêts à m’abattre. J’avais 16 ans, à peine. Le curé, qui m’aimait bien et parlait deux mots d’allemand, est arrivé in extremis. Il a plaidé ma cause pendant des minutes qui m’ont paru les plus longues de ma vie… Et il m’a sauvé. J’en ai fait une jaunisse ! C’est sans doute aussi pour cela que toute la période antérieure s’est effacée de ma mémoire. Puis la vie a repris son cours, je me suis mis à jouer au basket. Un communiste avait décidé d’ouvrir un club, nous avons ensemble fabriqué un terrain avec deux paniers. Tout est parti de là… Entre Beauvais et Songeons, il y avait le basket. J’ai passé un diplôme d’électricien, mais je crois que je n’ai exercé ce métier que pendant quelques jours, à Asnières. Le weekend, je rentrais jouer au basket. Notre équipe progressait de manière spectaculaire. Un jour, un gars m’a proposé de m’engager chez les pompiers de Paris. J’ai accepté pour des raisons que j’ignore encore… Mais le 8 avril 1948, le jour de mes 20 ans, je signais. Arrivé à la caserne, on m’a demandé ce que je savais faire. J’ai répondu : “Jouer au basket !” Cela a semblé leur suffire…
Dès lors, entre les interventions, les permanences et les entraînements physiques, nous jouions. Je faisais partie de cinq équipes, dont l’équivalent d’une formation de la Pro A d’aujourd’hui. Et, le travail payant toujours, nous avons remporté le championnat de France militaire en 1959 au stade Pierre de Coubertin, à Paris. Ce qui m’a valu ma première expérience dans les airs : un vol en DC3 Dakota pour aller en Algérie y rencontrer les vainqueurs du championnat ‘‘non métropolitain’’. Là, nous sommes tombés sur des durs à cuir mais l’avons tout de même emporté.
S’ils nous avaient seulement dit qu’une victoire leur aurait rapporté un voyage à Paris, nous les aurions laissés gagner…
Tests, taloches et turbulences
A cette époque, il y avait aussi l’athlétisme à l’UA 16e avec Maigrot, l’entraîneur de l’équipe de France. Mon 1,80 m en rouleau me valut alors aussi quelques titres. Puis un jour, j’ai eu envie de changer. J’ai déposé ma candidature pour une formation de pilote d’hélicoptère à Dax. Monsieur Sirvent était le patron du club de l’UA mais également celui de la protection civile. Je ne lui ai pas demandé de me pistonner mais de mettre ma candidature sur le haut de la pile. Et ça a marché. La suite est un mélange de peur et de bonheur. Nous n’avons été que trois ou quatre à réussir les tests. Le 4 octobre 1961, je me retrouve donc à Dax. Sans attendre, me voilà aux commandes (d’abord partagées) d’un avion. Moi qui n’avais vu que le cockpit d’un Dakota deux ans plus tôt ! De courts vols, pour commencer, de 30 à 45 minutes. Mais on ne me passe rien et l’un des instructeurs me tape sur le casque quand je fais une erreur… Insupportable ! Mais je m’accroche. Le 21 novembre 1961, j’accomplis mon premier vol seul. Je m’en souviendrai toute ma vie : un L18 jaune, 35 minutes. Et pendant ces minutes, une seule chose me hante : vais-je réussir à retourner sur terre vivant ? J’en ris maintenant, mais sur l’instant, je n’étais pas fier… C’est un passage obligatoire avant d’attaquer les cours sur hélicoptère. La protection civile s’apprête alors à ouvrir une base à Pau pour les interventions en montagne, et c’est ce à quoi je suis destiné… Là aussi, ça ne traîne pas. Le 20 décembre de la même année, j’effectue mon premier vol sur un Bell ; le 17 janvier 1962, en solo, toujours sur Bell, avec la même trouille ou peu s’en faut ; le 15 mars, le premier vol de nuit. Et là, autant te dire, il n’y a rien de rien pour se repérer au sol. Juste les lumières des routes et des maisons… qui disparaissent une fois arrivé en montagne. Le 11 avril de cette même année, je passe sur Alouette 2 à turbine. Cela me paraît tout de suite plus simple que le Bell à pistons. C’est à ce moment que les choses sérieuses commencent. Nous sommes deux équipages (deux pilotes et deux mécaniciens) à Pau pour un seul hélicoptère. Nous campons dans un hangar attenant à l’aéroport. Personne ne sait rien de la pratique de la montagne en hélico. Et moi, je ne connais pas grand-chose au pilotage. Tout va très vite, on nous laisse une grande liberté, on nous fait confiance. Je suis heureux. Même si j’apprends, de temps à autre, la disparition d’un pilote ou d’un officier avec lequel j’ai volé. De façon étrange, il arrive surtout des misères aux cons. La montagne et le ciel exigent de l’humilité et de la simplicité. C’est comme dans le sport : on peut se la raconter, mais pas avant d’avoir fini et bien fini son boulot.

L’Alouette de la protection civile, le premier hélicoptère à voler dans les Pyrénées. Le sauvetage en montagne était un métier en cours d’invention. Michel Cozette était de ces pionniers.
Planer sur les Pyrénées
Dès lors, je passe ma vie en l’air. J’apprends à chaque seconde. Au départ, personne ne sait vraiment à quoi peut bien servir notre présence à Pau. Mais, petit à petit, on nous appelle pour des missions diverses : monter du matériel médical, de travaux publics, des médecins en urgence, assurer une présence sur le Tour de France, sur le rallye des Cimes, à Saint-Jean-Pied-de-Port, au Grand Prix de Pau… Nous découvrons aussi les dangers du pilotage en montagne. C’est souvent ‘‘passé fin’’ là-haut. Je me souviens d’une fois où, en grimpant vers la brèche de Roland, dans le cirque de Gavarnie, j’ai été happé par un courant ‘‘rabattant’’. Instinctivement, on est tenté de vouloir lutter pour en sortir. Mon instructeur m’avait dit une fois lors d’un entraînement : ‘‘Si cela t’arrive, laisse-toi porter. Tu n’iras de toute manière jamais plus loin que le plancher des vaches.’’ J’applique illico la leçon, me laisse dériver et… me retrouve 20 kilomètres plus loin en Espagne. Mais vivant ! Ah, l’Espagne ! Nous en avons fait des manœuvres pour nos voisins, allant même jusqu’à monter les bornes en béton servant à délimiter la frontière. Les maçons rampaient autour du Bell de peur de se faire décapiter. Ils n’avaient jamais vu d’hélico.


Michel Cozette et Pierre Fortin, pilote et mécano. Pour le meilleur et pour le pire. Comme les doigts de la main.
« Nous étions des pionniers. C’était un temps où nous volions à 160 km/h, à peine plus vite qu’une auto… »
Au début de années 1960, la montagne en hélicoptère, c’était une chose balbutiante. Les Pyrénéens étaient regardés avec dédain par les Alpins. Mais je crois bien que les ‘‘montées circulaires’’, c’est nous qui les avons initiées. Nous étions des pionniers. C’était un temps où nous volions à 160 km/h, à peine plus vite qu’une auto. Moi, ce que j’aimais par-dessus tout, c’était grimper au-dessus des nuages. Loin de tout. Car si la montagne est belle vue du sol, elle est sublime vue de là-haut. Nous avons une fois sauvé un jeune berger qui s’était fracturé le crâne, à Bedous. J’avais à l’occasion écopé d’un blâme et d’une interdiction de voler la nuit. Mais le gamin était vivant. A partir de là, les missions se sont davantage dirigées vers le sauvetage en montagne. Il y en eut plusieurs du genre. Nous pouvions même directement acheminer les blessés vers les gros hôpitaux de Bordeaux. A Pau, pour atterrir plus près de l’hôpital, on me dégageait la grande place de Verdun et on l’éclairait, la nuit, avec des feux de voitures en cercle. Chaque fois, c’était la présence de l’hélicoptère qui se révélait déterminante.

Au-dessus du “Beth Ceu de Pau”, en béarnais le beau ciel de Pau, et du château du bon roi Henri IV.
« Mes passagers étaient saufs mais ils m’ont collé deux semaines aux arrêts. Une injustice immense… Je leur ai dit “merde” et je suis parti. »
Escadron en perdition
Et puis, il y eut cette aventure avec des militaires espagnols. Un escadron d’une quarantaine de soldats était parti en montagne, sans équipement contre le froid ni pour la nuit. Soudain, le mauvais temps tombe sur eux : brouillard, neige et grand froid. Les caprices de la montagne. Ils se sont perdus au dessus de Larrau et les choses se sont vite gâtées. On m’a demandé si je voulais tenter de les rejoindre, en m’avertissant du danger. Le brouillard était là, jusque dans la vallée. J’ai dit que je voulais bien essayer. Avec mon mécano, Pierre Fortin, nous avons décollé et cherché des ‘‘trous’’ pour grimper. De fil en aiguille, nous avons pu trouver des passages et approcher de leur zone, dans le brouillard. Je m’en souviens très bien. C’était le 24 octobre 1964. Nous n’avions pas réfléchi au danger : nous aimions ce métier. En arrivant sur place, quatre soldats avaient déjà péri de froid. Nous avons chargé les plus faibles et débuté des rotations. C’était chaud. Mais, au final, nous avons sauvé les vingt-sept autres. La France m’a décoré de l’ordre du mérite mais les Espagnols en ont fait des tonnes ! J’ai été décoré en grande pompe au consulat espagnol de Pau par un ministre venu de Madrid. La plus haute distinction civile espagnole avec les honneurs et tout le tralala. On ne parlait que de cela dans les journaux. Puis la vie a repris et je pense que, sur cette période, nous avons dû sauver une quarantaine de personnes. Nous aimions cela : la montagne, les hélicos, une camaraderie, le sentiment de vivre et d’être utiles. Bref, tout ce qui nous permettait de nous sentir vivants. Et puis, un jour, en faisant visiter le complexe gazier de Lacq à des notables de la région, nous sommes passés au-dessus d’une cheminée crachant de la vapeur d’eau. Trop bas. Elle était invisible, je ne me suis pas inquiété. J’ai fait l’erreur de ma carrière. La turbine s’est éteinte et n’a pas voulu redémarrer. J’ai appliqué les consignes sans tarder : autorotation et tirage de manche avant l’atterrissage. Cela semblait fonctionner. J’ai ralenti la chute. Mais la manœuvre s’est achevée à 7 ou 8 mètres du sol. Nous nous sommes crashés de cette hauteur. J’avais la colonne vertébrale cassée en deux endroits mais mes passagers étaient saufs. Ils m’ont collé deux semaines aux arrêts. C’était une injustice immense. Sans compter les six mois d’hôpital… Je leur ai dit ‘‘merde’’ et je suis parti.
La passion toujours intacte
La base était alors en construction et l’aventure débutait. Elle fêtera d’ailleurs ses 50 ans dans quelques semaines. J’espère qu’ils se souviendront de moi. Cela me ferait tellement plaisir de voir ces hélicos modernes qui montent à 4 000 m quand nous plafonnions à 200. Tu sais, jusqu’à l’apparition des boîtes noires, ils me laissaient encore venir avec eux et parfois piloter. Et je les regarde encore, à 83 ans, passer au-dessus de chez moi avec envie, chaque jour ou quand je vais à la pêche. Les plus belles années de ma vie, sans aucun doute. » Michel Cozette se replonge dans l’album de ces années. Avec une pointe de regret de ne pas avoir poursuivi l’aventure et d’avoir claqué la porte. Mais avec la satisfaction d’être toujours là, ses deux mécaniciens pas loin, pour refaire le monde, et la montagne, de temps à autre. Jamais il n’avait ouvert son album avec moi. Jamais, il ne m’avait raconté tout cela. Sa pudeur a la taille de son caractère emporté. Je ne savais pas que mon père était un héros.♦

A 83 ans, Michel Cozette continue à suivre les rotations de la protection civile en direction des Pyrénées.
Cela ne lui est jamais passé.
À découvrir aussi dans le volume #5

DÉCALÉ
Il faut être fou ou être Anglais pour aller à l’usine en Aston Martin de Grand Prix.

BÂTISSEUR
Le “sorcier” Patrick Godet est le seul au monde à être habilité par Egli et Vincent.

TEST(OSTÉRONE)
En hommage à Tyrrell, nous avions essayé, après sa disparition, “sa” dernière F1, la 025.